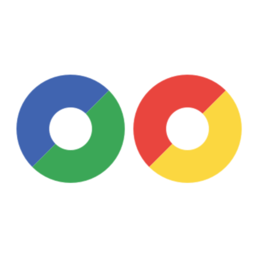Deuxième pathologie neurodégénérative après Alzheimer, la maladie de Parkinson se caractérise par la disparition progressive des neurones dopaminergiques qui se situent dans la partie noire du cerveau. Ce sont elles qui permettent la fabrication de la dopamine, une molécule responsable du contrôle des mouvements. Leur dégénérescence entraîne lenteur, tremblements et rigidité.
Les traitements médicamenteux
Pour pallier ce déficit, plusieurs solutions existent.
- La lévodopa, précurseur de la dopamine, demeure la molécule de référence. Elle restaure efficacement les fonctions motrices.
- D’autres, comme les agonistes dopaminergiques, imitent directement l’action de ce neurotransmetteur.
- S’y ajoutent des substances qui empêchent la dégradation de la dopamine dans le cerveau ou encore des médicaments qui bloquent les récepteurs du glutamate, un autre neurotransmetteur impliqué dans les désordres moteurs.
Dans les cas les plus avancés, il est possible :
- D’administrer les traitements en continu grâce à des pompes délivrant la lévodopa.
- D’implanter un pacemaker pour corriger les circuits neuronaux défaillants. Cette stimulation cérébrale profonde, bien que lourde, offre à certains malades une nette réduction des symptômes.
Les approches non médicamenteuses
Au-delà des médicaments, un accompagnement global est indispensable. La kinésithérapie aide à maintenir la mobilité, l’orthophonie préserve la parole et la déglutition, tandis que l’accompagnement psychologique demeure indispensable pour aider les patients et leurs proches à surmonter l’anxiété et la dépression associées à la maladie.
Les séjours en cures spécialisées apportent des soins pluridisciplinaires favorisant la rééducation et le repos.
La gestion thérapeutique de la maladie de Parkinson est complexe. En effet, diverses approches (médicales, chirurgicales, rééducatives… sont généralement combinées pour offrir une prise en charge optimale des symptômes de la maladie.