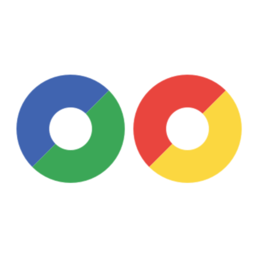Étape naturelle dans la vie d’une femme, la ménopause se manifeste généralement vers la cinquantaine. Toutefois, il arrive qu’elle survienne beaucoup plus tôt : on parle alors de ménopause précoce. Elle apparaît lorsque la fonction ovarienne est perturbée, réduisant sa capacité à produire des hormones et à libérer des ovules régulièrement. 1% des femmes de moins de 40 ans sont concernées.
Cinq facteurs déclencheurs possibles
- L’hérédité : les femmes ayant des antécédents familiaux d’insuffisance ovarienne précoce ont plus de risques d’y être elles-mêmes sujettes.
- La génétique : c’est le cas du syndrome de Turner qui correspond à une anomalie des chromosomes sexuels.
- Une maladie auto-immune : certaines pathologies comme la thyroïdite de Hashimoto, le diabète de type 1 ou la polyarthrite rhumatoïde produisent des anticorps qui peuvent attaquer les propres organes du corps, dont les ovaires.
- Les traitements anti-cancer : les femmes ayant été traitées par chimiothérapie ou radiothérapie sont plus exposées. Ces traitements peuvent en effet altérer la fonction ovarienne.
- Le tabagisme : fumer impacte aussi la fertilité et accélère le vieillissement ovarien.
Trois examens nécessaires pour établir le diagnostic
- Un test de grossesse afin de s’assurer que ce n’est pas la raison de l’arrêt des règles.
- Plusieurs prises de sang sont réalisées pour mesurer les taux d’œstrogènes et de FSH (hormone folliculo-stimulante), sur plusieurs semaines. Si les résultats confirment une baisse persistante de l’activité ovarienne, le diagnostic peut être posé.
- Un dosage de l’hormone antimüllérienne permet également d’évaluer la réserve ovarienne.
En cas de confirmation, une prise en charge médicale et psychologique s’avère nécessaire pour préserver la santé et la qualité de vie des femmes touchées.