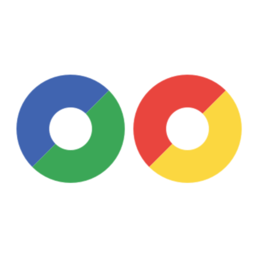La sclérose en plaques (SEP) est une pathologie complexe qui touche le système nerveux central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). Comme l’explique l’Institut du Cerveau, elle se caractérise par des lésions « les plaques » dans lesquelles la gaine protectrice des neurones « la myéline » est détruite entraînant une dégénérescence des cellules nerveuses, avec une perte de la communication entre le cerveau et les organes périphériques.
Les différentes approches thérapeutiques
La prise en charge de la SEP repose sur plusieurs types de traitements, adaptés à l’évolution de la maladie et aux besoins de chaque personne. Ils ont pour objectif de réduire l’intensité ou le nombre de poussées, ralentir la progression du handicap et soulager les différents symptômes pour améliorer la qualité de vie, indique France Sclérose en Plaques.
- Le traitement des poussées. Lorsque apparait de nouveaux symptômes ou une aggravation de troubles existants, le traitement le plus courant repose sur la prise de corticoïdes à forte dose afin de réduire l'inflammation autour des nerfs et d’accélérer la récupération après une poussée.
- Le traitement de fond des formes rémittentes. Les périodes de poussées sont suivies de rémissions. Le traitement de fond vise à réduire la fréquence et la sévérité des poussées. Il s'agit généralement de médicaments immunomodulateurs ou immunosuppresseurs, pour ralentir la progression de la maladie et pour maintenir une qualité de vie acceptable.
- Les traitements des formes progressives. Dans les formes progressives, la SEP progresse de manière continue sans poussées marquées. Cette forme de la maladie est plus difficile à traiter. Des médicaments spécifiques, comme l’ocrelizumable, contribuent à tenter de ralentir l’évolution de la maladie.
En fonction de la forme et de l’évolution de la maladie, l’objectif reste d’optimiser la prise en charge afin de limiter les handicaps et de préserver la qualité de vie ou encore de mener une grossesse à terme.