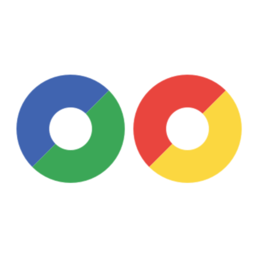Le terme hikikomori, du japonais « hiku » signifiant « tirer vers soi », et « komori » « s'enfermer ». Ce phénomène apparut au Japon dans les années 1990. Il désigne un syndrome d’isolement particulièrement extrême. Inclus dans ce qu'on appelle les NEETs (les jeunes de 15 à 29 ans sans étude, sans formation et / ou sans emploi), les hikikomoris derniers représentent près de 12,8 % de cette tranche d'âge en France, soit plus d'1,4 million de personnes, selon l’Insee (janvier 2023).
Comment l’identifier ?
Comme son étymologie l’indique, il correspond littéralement à un repli sur soi, un retrait social dans un lieu protecteur (appartement ou chambre), se coupant totalement du monde extérieur pendant des mois, refusant toute interaction sociale ou professionnelle.
Quelles peuvent être les causes ?
Traumatisme, harcèlement scolaire, sentiment d’incompréhension… plusieurs facteurs contribuent au développement de ce syndrome qui affecte la santé mentale. Il représente une véritable détresse psychologique nécessitant une prise en charge spécifique.
Dans certains cas, un accompagnement médicamenteux permet de soulager les symptômes anxieux ou dépressifs associés.
La prévention passe par la sensibilisation des familles, des établissements scolaires et des professionnels de santé. Érigée « Grande Cause nationale 2025 », la santé mentale est une priorité de santé publique.